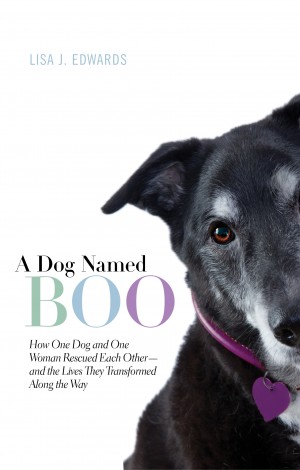A l'heure où le film Gravity – qui raconte une expédition à bord d'une navette spatiale qui tourne à la catastrophe – fait salle comble et a déjà propulsé plus d'un million de spectateurs français dans l'espace, une étude estime qu'au moins 2 milliards de planètes de taille terrestre, en orbite autour d'étoiles similaires au Soleil, seraient habitables dans notre galaxie. C'est plus que ce qui avait été estimé jusqu'à présent, rapporte le Guardian, citant l'étude. La plus proche se trouverait à "seulement" douze années-lumière (une année-lumière équivaut à 9 461 milliards de km) et est même visible à l’œil nu.
Les scientifiques se sont appuyés sur les données des trois premières années d'observation du télescope Kepler. L'étude, publiée lundi 4 novembre dans les comptes-rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS), a été présentée lors d'une conférence sur la mission Kepler qui se tient cette semaine à Moffett Field, en Californie.
Des températures sous lesquelles l'eau peut exister
L'étude révèle qu'une étoile sur cinq semblable au soleil dans l'univers – soit quelque 55 milliards tout de même – a en orbite une planète dont la taille est similaire ou proche de celle de la Terre, et qui se trouve ni trop éloignée ni trop rapprochée de leur astre, ce qui permet de trouver à leur surface des températures permettant la présence d'eau, et donc potentiellement la vie. "Ces résultats laissent penser que des planètes comme la Terre sont relativement fréquentes dans toute la Voie lactée", relève Andrew Howard, coauteur et astronome à l'Institut d'astronomie de Hawaï.
Grâce aux informations de Kepler, les astronomes ont en effet détecté 3 538 exoplanètes potentielles, dont 833 confirmées. Parmi ces dernières, 647 sont de taille terrestre, dont seulement 104 se trouvent dans une zone leur permettant d'être habitables, et dix paraissent être rocheuses comme la Terre.
Des températures trop élevées pour des organismes vivants
Le fait qu'une planète de masse comparable à la Terre se trouve dans une zone où elle pourrait être habitable ne la rend pas forcément propice à la vie, expliquent toutefois les scientifiques. "Certaines pourraient par exemple avoir des atmosphères trop épaisses, rendant les températures à sa surface trop chaudes pour des organismes vivants, note par exemple Geoffrey Marcy. En fait nous ignorons encore l'étendue des types de planètes et de leurs environnements où la vie pourrait exister."
La semaine dernière, ces astronomes avaient annoncé la découverte de l'exoplanète Kepler-78b qui, malgré une taille et une composition similaires à la Terre, est inhabitable en raison de ses températures, qui s'élèvent de 1 500 à 3 000 °C.
"La connaissance de planètes semblables à la Terre, en orbite autour d'étoiles relativement proches, simplifiera les futures missions de la NASA, et lui permettra de les étudier en détail", explique Andrew Howard. Selon Natalie Batalha, autre scientifique de la mission Kepler, "d'ici une cinquantaine d'années nous serons capables d'observer les caractéristiques de l'atmosphère de ces exoplanètes et ensuite l'objectif sera de prendre des images de bonne qualité de leur surface, voir la topographie et chercher les signes de la vie".
Avec un fonds alloué de 600 millions de dollars, la mission Kepler a été lancée en 2009 pour scruter pendant au moins quatre ans plus de 100 000 étoiles ressemblant au Soleil, et situées dans la constellation du Cygne et de la Lyre, dans notre galaxie. Sa mission a été prolongée une première fois en novembre 2012.
En juin déjà, des astronomes de l'Observatoire européen austral avaient découvert dans la constellation du Scorpion un système solaire "doté d'une zone habitable bien remplie", avec trois "super-Terres" où les conditions seraient compatibles avec l'existence d'eau liquide.
Source : lemonde.fr