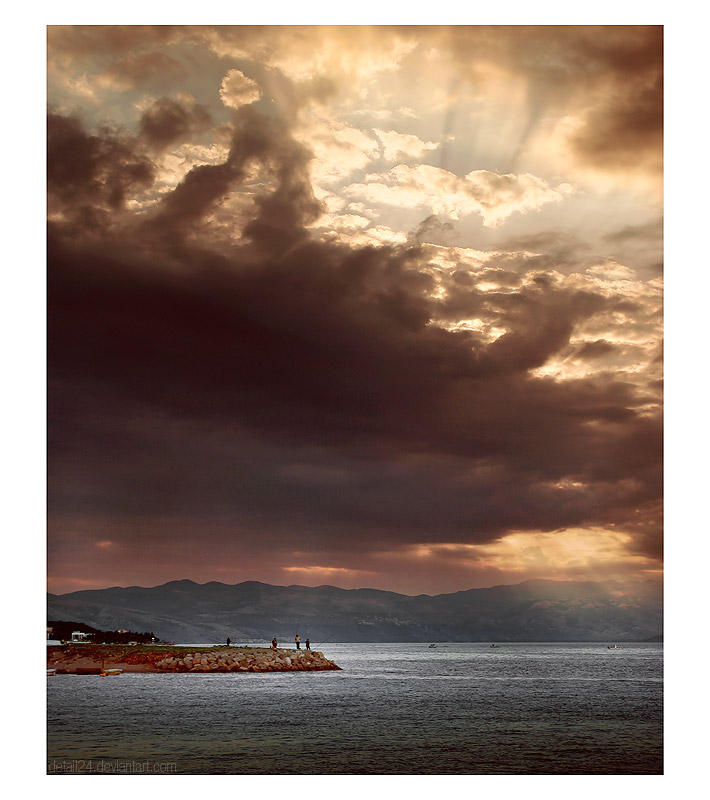Quand les trois vagues de vingt-quatre mètres de haut du tsunami de
décembre 2004 ont frappé la baie de Bon Yai, au sud de l’île de Surin,
la tribu Moken, une petite communauté nomade de pêcheurs, a été témoin
de l’anéantissement de son village et de la mort instantanée de 24 000
villageois qui s’étaient réfugiés sur l’une des plus hautes collines de
l’île. Les anciens avaient prévenu toute la tribu des Moken,
c’est-à-dire 200 personnes, et tous, à part un garçon handicapé, ont
réussi à se sauver bien avant que les vagues n’arrivent. Quand le
tsunami a balayé le nord, en atteignant les îles d’Andaman, de Nicobar
et le sud de l’Inde, les 250 membres de la vieille tribu Jarawa, seuls
occupants de l’île de Jirkatang, ont tous fui dans la forêt de Balughat.
Ils ont vécu pendant 10 jours de noix de coco et s’en sont sortis.
Tous les membres des quatre autres tribus indigènes de l’archipel indien
des îles Andaman et Nicobar – les Onges, les Grands Andamanais, les
Sentinelles et les Shompen – ont eux aussi eu la prémonition du tsunami,
alors que d’ordinaire ils auraient dû être en mer en train de pêcher.
Quand un hélicoptère indien a survolé l’île, pour chercher des
survivants, une Sentinelle nue, offensé par cette intrusion sans raison
d’être, a brandi son arc et lancé une flèche vers l’engin.
Quand on leur a demandé comment ils savaient que le tsunami arrivait, un
ancien de la tribu a haussé les épaules. C’était évident. L’un des
petits garçons de la tribu avait été pris de vertiges. Le niveau du
ruisseau près de leur village avait soudain baissé. L’un des membres de
la tribu avait remarqué des petites différences entre la façon dont une
vague grossissait par rapport à une autre. Ils avaient remarqué une
agitation inhabituelle chez les plus petits mammifères qui griffaient
davantage, une légère altération dans les figures de nage des poissons.
Quand il était enfant, on avait appris à l’ancien à faire attention à
ces signaux subtils. Ils annonçaient des secousses de la terre et de la
mer qui allaient se déchaîner avec rage. L’ancien avait compris que les
signes étaient là, que la mer et que la Terre étaient « en colère » et
que son peuple devait se réfugier sur les plus hautes Terres.
L’une des régions les plus affectées par le tsunami comprenait le Yala
National Park, la réserve de vie sauvage la plus grande du Sri Lanka, où
les raz-de-marée ont inondé jusqu’à 3km à l’intérieur des terres.
Pourtant, selon Ravi Corea, président de la Sri Lanka Wildlife
Conservation Society, parmi toutes les centaines d’animaux de la
réserve, seulement deux buffles d’eau sont morts. Des centaines
d’éléphants, de léopards, de tigres, de crocodiles et de petits
mammifères se sont cachés dans leurs repaires ou se sont sauvés pour se
mettre à l’abri.
La survie remarquable des animaux sauvages et des peuples indigènes a
été attribuée à un sens très aigu de l’ouïe, à un don « sismique » qui
leur permet de sentir les vibrations d’un tremblement de terre, ou à une
compréhension ancestrale des changements subtils dans le vent et dans
l’eau. « Ils peuvent sentir le vent », déclare Ashish Roy, avocat et
activiste environnemental, en parlant des indigènes. « Ils peuvent
jauger de la profondeur de la mer rien qu’avec le son de leurs rames.
Ils ont un sixième sens que nous ne possédons pas. »
Mais il y a une autre possibilité qui est quelque chose d’encore plus
extraordinaire : une différence énorme entre la façon dont ils voient le
monde et la façon dont nous le voyons. (...)
Nous avons perdu notre sens du
lien, mais notre perte n’est pas
irrévocable. Nous pouvons remettre l’intégralité dans nos vies et
retrouver le sentiment de la connexion entre les choses, mais cela
nécessite de suivre une série de règles très différentes de celles avec
lesquelles nous vivons à présent. Vivre le
lien, c’est
s’abandonner à la poussée de la nature vers l’intégralité et reconnaître
le tout dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Nous devons nous
poser certaines questions fondamentales : comment pourrions-nous voir le
monde comme autre chose qu’un lieu qui existe seulement pour nous ?
Comment pourrions-nous avoir des relations les uns avec les autres qui
ne soient pas basées sur la compétition ? Comment pourrions-nous nous
organiser dans notre voisinage – la tribu immédiate autour de nous et
notre plus petit groupe en dehors de la famille – pour nous soutenir
mutuellement plutôt qu’entrer en compétition ?
Nous avons besoin de percevoir différemment le monde, de communiquer
différemment avec les autres, de nous organiser – d’organiser nos
amitiés, notre voisinage, nos villes et nos cités différemment. Si nous
ne voulons pas être séparés, mais toujours attachés et engagés, nous
devons changer notre but fondamental sur Terre en quelque chose de plus
grand que celui qui est fondé sur la lutte et la domination. Nous devons
voir nos vies à partir de perspectives complètement différentes, d’un
point de vue plus large afin que nous puissions voir finalement
l’interconnexion. Nous devons changer la façon même de voir le monde,
afin de voir comme voient les Moken, non pas pour prévenir les tsunamis,
mais pour remarquer les connexions qui nous lient tous ensemble. (...)
Nous avons oublié comment regarder. Nous ratons la connexion subtile,
l’idée périphérique, le moindre changement dans le vent qui nous
amènerait à la conclusion inéluctable qu’un tsunami se prépare. Même les
Moken qui étaient sur leurs bateaux avant que le tsunami ne frappe ont
su aller vers les eaux plus profondes et s’éloigner du bord,
contrairement à leurs voisins, les pêcheurs birmans, qui ont péri. Un
Moken a accueilli la nouvelle de leur mort d’un hochement de tête : «
Ils pêchaient des sèches. Ils n’ont rien vu venir. Ils ne savent pas
comment regarder. »
Nous avons vu que notre besoin le plus fondamental est de toujours
chercher un lien et une unité, et d’aller au-delà de l’individualité.
Pourtant, quand nous regardons notre monde, nous ne voyons que des
choses individuelles, séparées et sans rapport. Nos impulsions les plus
basiques sur nous-mêmes vont à l’encontre de la façon actuelle dont nous
voyons et interprétons notre monde. En apprenant à voir comme un Moken,
à voir l’espace entre les choses, nous pouvons apprendre à reconnaître
les connexions qui ont toujours été présentes, mais qui sont restées
invisibles à l’œil occidental : les connexions qui nous lient ensemble.
Nous commencerons à reconnaître ce qui est le plus invisible : l’impact
de nous-mêmes sur les autres et sur ce qui nous entoure.